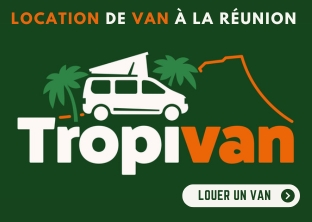L'artisanat du bois
"De toute évidence, c'est à travers la transformation du bois que transpire le mieux l'âme créole". Nulle citation ne pourrait
mieux exprimer que cette phrase - que l'on doit à la plume de Tony Manglou.
L'artisanat du bois, l'un des plus anciens mais aussi des plus traditionnels, peut être considéré comme l'un des piliers, et même le pilier central de tout l'artisanat réunionnais.
Les styles importés ont été adaptés aux exigences du pays, tout particulièrement au climat, à l'harmonisation avec l'habitat et à l'utilisation des essences locales (tamarin,
camphrier, petit natte, grand natte, bois d'olive, bois noir, letchi, manguier, jacquier) et autres essences dont certaines sont devenues très rares, sont très appréciées en ébénisterie
de haut de gamme, ainsi qu'en marquetterie.
La forêt réunionnaise de bois de couleur avait été partiellement détruite par une exploitation incontrôlée. Mais depuis
une trentaine d'années, grâce aux efforts réalisés par l'O.N.F et les pouvoirs publics, on assiste très progressivement à une reconstitution de ces essences fabuleuses.
Cette reconstitution exigera plusieurs décennies - au moins un siècle pour certaines variétés - avant que l'on puisse retrouver la
forêt réunionnaise d'antan et l'exploiter cette fois de façon rationnelle.Il faut alors souhaiter que les artisans ébénistes du futur maintiennent haut et fier l'héritage de leurs ancêtres
et maîtres et soient aussi aptes que ceux-çi à produire un mobilier qui fait la fierté de l'île de la Réunion.
La musique créole réunionnaise
La musique créole contemporaine est la résultante de la fusion des traditions musicales noires et blanches du siècle dernier.
Les noirs, avec leur sens inné du rythme, y ont apporté une touche particulière, dont l'aboutissement le plus répandu est le séga actuel et le maloya.
Mais l'expression musicale créole s'est traduite parallèlement par un développement de la chanson auquel se mêle tantôt le rythme du séga, tantôt une certaine mélancolie, à travers laquelle
s'exprime l'âme réunionnaise, sous forme de romances.
La plus célèbre d'entre elles reste "P'tit fleur fanée", de Georges Fourcade, considérée un peu par tous ceux qui vivent
ici comme l'hymne à la Réunion.
Il s'est d'ailleurs instauré une sorte de tradition qui fait qu'à l'issue des nombreux dîners auxquels sont conviées les hautes
personnalités de passage, et en dehors des réceptions protocolaires,
chaque convive prend ses deux proches voisins par le bras et, chacun se balançant au rythme de la musique, termine la soirée sur cette douce et belle mélodie.
Le séga est devenu, aux îles Mascareignes, ce que le tango et le paso doble sont à l'Espagne.
Le maloya, danse plus primitive, se traduit par un rythme plus lancinant dont l'origine remonte au temps de l'esclavage. Les noirs se réunissaient
le soir pour chanter leur misère sous formes de mélopées interminables, comme le faisaient également les esclaves noirs des plantations
de coton de la Louisiane.
Tout comme le séga, le maloya est une danse où s'exprime la sensualité, et dans laquelle on se livre à l'approche érotique du partenaire.
Les instruments utilisés par les troupes folkloriques réunionnaises sont de fabrication locale.
On distingue notamment :
- Le caïamb ou cayambe fait de tiges de fleurs de canne remplies de graines de safran.
- Le "houlèr" ou houler qui est un tam-tam.
- Le bobre qui est un arc d'origine africaine.
A ces instruments, s'ajoutent le banjo, la guitare, le violon et l'accordéon et, plus récemment, guitares électriques, batteries
et orgues électroniques.
Comment venir ?
Le climat et saisons
Période cyclonique
La télécommunication
Le décalage horaire
L'histoire
Le créole
La population
Les codes postaux
Les 24 communes
Réservez en ligne votre vehicule !
Nous vous proposons un service de location de voiture en partenariat avec le réseau des loueurs indépendants de la Réunion.
Un listing des meilleurs tarifs vous seront affichés et vous pourrez effectuer votre demande de réservation directement en ligne.
Un vaste choix de véhicules !
De la petite citadine, compacte, berline, 4x4, SUV, monospaces 7 places, minibus 9 places.... tout y est !
Pour les catégories les plus rares comme le 4x4, 7 places ou 9 places il est conseillé de réserver à l'avance pour s'assurer de la disponibilité !